Prologue
“Arrière-grand-papa qu’as-tu fait au Cameroun ?”. Cette paraphrase de l’ouvrage de Raphaëlle Branche Papa qu’as-tu fait en Algérie. Enquête sur un silence familial 1 paru en 2020 n’est cependant pas tout à fait correcte. Il s’agirait plutôt de se demander “Arrière- grand-papa, que t’as-t-on fait au Cameroun ?”. Cette interrogation proche de celle de l’historienne initie cependant bien une enquête sur un silence familial, national même. Ce travail de recherche en histoire orale se propose ainsi comme une tentative de compréhension de ces non-dits. Je n’ai en effet appris que tout récemment un pan de l’histoire familiale, nationale. Un arrière-grand-père, un Camerounais, assassiné par des troupes françaises, dans le contexte d’une guerre d’indépendance ne disant pas son nom. Pure invention pour l’ancien Premier Ministre François Fillon, “répression 2” pour le précédent Président de la République François Hollande, l’on n’est pas loin sémantiquement des événements algériens euphémisant la guerre d’Algérie. Des “minimisations langagières 3” certaines qui édulcorent une réalité. Toujours selon l’historien en effet, “reconnaître la guerre, cela obligerait à s’interroger sur le cheminement d’une démocratie française qui n’a pas jugé utile, à temps, d’exporter ses principes universels hors de l’Hexagone 4 ”. Si Benjamin Stora écrit ces propos en pensant à la guerre d’Algérie, ces derniers s’appliqueraient tout aussi bien à la guerre camerounaise. Cette non-reconnaissance, comme je le préciserai dans la suite de mon article, participe de fait grandement à une méconnaissance, familiale et nationale, de cette guerre d’indépendance. Comment comprendre ce silence autour de violences ayant entraîné la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes ? En quoi est-il finalement symptomatique d’une “crise de la transmission 5”, tout autant privée que publique ? Autant de problématiques qui permettent d’esquisser un potentiel oubli familial, d’entrapercevoir la (non) fabrique d’une mémoire collective par l’école, et de se questionner sur l’existence en France d’un “passé qui ne passerait pas 6”, l’histoire coloniale.
S’il n’est pas question dans cet article d’expliciter tous les événements de la guerre ayant eu lieu au Cameroun principalement de 1955 à 1962, il m’apparaît important de justifier le bornage chronologique choisi pour les entretiens menés. Ce bornage diffère en effet selon les historiens et ouvrages sur le sujet, certains préférant par exemple initier la guerre en 1948 et la conclure en 1971. 1955 tout d’abord, car cette année est celle des premières grandes grèves et manifestations populaires en faveur d’une autonomie politique et économique, et des premières grandes répressions menées par l’armée française. C’est également cette même année que le parti indépendantiste et en faveur de la réunification du pays, l’Union des Populations du Cameroun (UPC) (rappelons en effet que le Kamerun, ancienne colonie allemande, est partitionné à l’issue de la Grande Guerre en deux mandats distincts, l’un français, l’autre britannique), est interdit par l’administration coloniale. 1962 ensuite, bien que cette date ne marque l’arrêt total des opérations militaires camerounaises (épaulées par des militaires et conseillers français) menées contre les indépendantistes, ces derniers estimant que l’indépendance obtenue en 1960 n’est que factice. En effet, en 1962, l’ampleur de la répression diminue et cette dernière devient plus épisodique. Par ailleurs, le territoire camerounais est inégalement concerné par les combats. Ce sont en effet principalement les régions de l’ouest du pays qui sont le plus troublées par les conflits, en pays bassa et bamiléké notamment. Les maquis, zones de pacification et camps accueillant les populations civiles déplacées sont quant à eux concentrés notamment en Sanaga- Maritime.
Bien que peu d’ouvrages relatifs à la guerre d’indépendance camerounaise existent (ce point est l’objet d’un développement ultérieur), j’invite les personnes désireuses d’approfondir le sujet à lire la synthèse proposée par Jacob Tatsitsa, Manuel Domergue et Thomas Deltombe : Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique. 1948-1971 7. Le titre a paru en 2011. Cette enquête journalistique, si elle ne problématise quelques fois pas assez des faits historiques et historiographiques, résume cependant justement les principaux événements relatifs à ce conflit et constitue une porte d’entrée appropriée pour comprendre la guerre d’indépendance camerounaise. Cette dernière n’est cependant la thématique centrale de mon travail de recherche. Je choisis en effet d’étudier plus spécifiquement la transmission et la mémorisation de ces violences, initialement au sein de l’espace privé. Initialement seulement, car il s’est avéré que les espaces privé et public étaient traversés par des mécanismes de mémorisation et de transmission semblables. Il est possible de comprendre cette proximité et ces allers et retours entre espaces public et privé à l’aide de Maurice Halbwachs et de sa réflexion sur la mémoire collective 8. ]. Dans son ouvrage éponyme, il apparaît en effet que tant la famille que la nation peuvent être assimilées à un groupe créancier et débiteur de souvenirs et d’une mémoire collectifs. Pierre Nora définit quant à lui la mémoire collective comme un “souvenir ou ensemble de souvenirs, conscients ou non, d’une expérience vécue et/ou mythifiée par une collectivité vivante de l’identité dans laquelle le sentiment du passé fait partie intégrante 9”. Les entretiens réalisés au sein de ma propre famille permettent de ce fait un accès privilégié aux mémoires familiale puis nationale, toutes deux collectives.
Au total, 5 entretiens furent réalisés, respectivement avec mon père, ma soeur et certains de mes cousins et cousines. Les entretiens furent conduits suivant un modèle semi- directif séquencé en trois parties distinctes. La première fut consacrée à une présentation du témoin, tandis que la deuxième interrogeait la connaissance des violences survenues au Cameroun. Finalement, la troisième et dernière partie était consacrée à la mémorisation et la transmission de ces violences. Chaque partie commençait par une question ouverte puis était suivie de relances thématiques pour aborder ou revenir sur des points qui n’auraient été que peu mentionnés par le témoin lors de la question ouverte. Finalement, le témoin avait la possibilité à la fin de l’entretien de compléter ses propos. En raison de mon choix d’interviewer uniquement des membres de ma propre famille, ce travail de recherche en histoire orale m’a conduite à m’interroger également sur la réflexivité nécessaire de l’historien vis-à-vis de son propre travail. L’utilisation du vouvoiement ou du tutoiement lors des entretiens, les familiarités certaines entretenues avec les témoins, de potentielles attentes ou connaissances, autant de questionnements et de choix de positionnement auxquels je dus répondre au cours de mon travail de recherche. C’est ainsi volontairement que je choisis d’adopter un ton personnel, avec notamment l’utilisation du pronom personnel “je”. Ce travail de recherche convoque ainsi, en plus de l’histoire et de l’historiographie, de la sociologie (de la famille principalement). En effet, appartenant à la “troisième génération” issue de l’immigration, c’est-à-dire les enfants dont le(s) grand-parent(s) étai(en)t immigré(s), je questionne également par ma recherche la transmission intergénérationnelle des mémoires des familles immigrées.
Mon travail de recherche est ainsi structuré en trois différentes parties, chacune centrée sur une socialisation. La socialisation familiale tout d’abord, en ce qu’elle est certainement la première que nous côtoyons, dès notre naissance. La socialisation scolaire ensuite, en ce qu’elle vient s’ajouter, quelques fois se contredire avec la socialisation familiale et qu’elle est aussi pensée comme déterminante dans l’acquisition d’une citoyenneté nationale. La socialisation “sociétale” finalement. Cette dernière se veut plus large que les deux précédentes, bien qu’elle ne puisse être définie explicitement. Trois socialisations différentes qui ne sont cependant exclusives l’une de l’autre, et qui permettent d’appréhender, les histoire et mémoire de la guerre d’indépendance camerounaise.
Un oubli familial
Une connaissance hétérogène de la guerre d’indépendance camerounaise
L’ensemble des entretiens réalisés permet d’affirmer que la guerre d’indépendance au Cameroun est extrêmement peu connue. Des figures majeures telles que celles de Ruben Um Nyobe ou Pierre Messmer n’évoquent rien aux témoins interrogés, notamment les plus jeunes, Français appartenant à la “troisième génération”. Le bornage chronologique ne peut également être expliqué, et la date même de l’indépendance du Cameroun en 1960 n’est quelques fois pas sue. Peu de témoins peuvent citer les principales régions concernées par la guerre, un ou plusieurs événements significatifs, le nom du parti indépendantiste, … Il est également arrivé qu’un témoin ne sache que des violences avaient eu lieu au tournant de l’indépendance. Au contraire cependant, certains témoins interrogés ont des connaissances précises de cette guerre, même si certains détails ou dates sont inconnus. Lors des entretiens, ces personnes-ci adoptent plus facilement que les autres une posture didactique, s’exprimant tout autant à l’intervieweur qu’à un public potentiel (“je rappelle pour ceux qui ne le savent pas”, …). Nombreuses sont en outre les personnes interrogées à effectuer un parallèle naturel entre le conflit camerounais et le conflit algérien. Il m’apparaît important de préciser que le conflit indochinois n’est jamais cité spontanément par les témoins, et même lorsque j’évoque ce dernier dans le cadre des décolonisations dites violentes, aucun des témoins ne remobilise cet exemple dans la suite de l’entretien.
Je remarque que cette connaissance hétérogène de la guerre d’indépendance camerounaise s’explique par deux variables principales. Tout d’abord, un intérêt pour l’histoire. Les témoins disposant d’un intérêt spécifique pour la discipline disposent en effet de plus de connaissances relatives à cette guerre d’indépendance. Si cet intérêt historique n’est pas perceptible dans les entretiens, ma proximité avec les personnes interrogées me permet néanmoins de confirmer cette affirmation. Ensuite, une autre variable est le type d’études effectuées. Les témoins effectuant ou ayant effectué des études supérieures dans des grandes écoles de l’enseignement supérieur (en école de commerce ou, pour ma part, en institut d’études politiques), disposent d’une connaissance plus approfondie du sujet que les autres témoins, qui réalisent également des études supérieures. Cette variable scolaire s’explique probablement par l’accent mis dans ce type d’études sur l’acquisition d’une “culture générale” la plus large possible. Par ailleurs, en classe préparatoire aux grandes écoles que plusieurs témoins ont suivi, un chapitre est consacré, au sein d’un panorama géopolitique global au XXe siècle, à une “géopolitique […] de la décolonisation jusqu’aux années 1990 10, n°1 du 11 février 2021 [consulté le 10 septembre 2021], p. 137. [Disponible sur : https://www.education.gouv.fr/bo/21/Special1/ESRS2035776A.htm]. ]”. Au sein de ce chapitre ont ainsi été évoquées des décolonisations violentes, bien que les témoins mentionnent que la guerre au Cameroun ne fut pas mentionnée. Finalement, l’origine ou l’insertion au sein de réseaux diasporiques camerounais ne sauraient être des facteurs explicatifs de cette connaissance hétérogène. En effet, tous les témoins ont des ascendances camerounaises et se sentent peu intégrés au sein de la diaspora camerounaise en France. Un témoin dit ainsi : “je ne me considère pas comme un digne représentant de la diaspora camerounaise en France”. Si tous les interviewés évoquent des liens familiaux ou quelques connaissances amicales d’ascendance camerounaise, aucun n’a de relations fortes vis-à-vis du Cameroun. Peu se sont ainsi déjà rendus dans ce pays, et en Afrique de manière plus générale.
Une fracture générationnelle et une “communautarisation” de la mémoire ?
La génération d’appartenance est au contraire une variable explicative importante : selon que l’on appartienne aux deuxième ou troisième générations, notre connaissance du conflit camerounais sera plus ou moins étendue. D’où l’existence d’une possible fracture générationnelle émergeant à la suite des entretiens réalisés. Malgré l’absence de toute référence à cette guerre à l’école (point sur lequel je reviendrai), je m’étonne tout de même que le conflit camerounais ne soit en effet pas plus connu au sein de ma propre famille, dont les racines sont camerounaises. Notre proximité avec ce pays ne devrait-elle donc pas nous amener à être plus sensibilisés à cette guerre que des personnes n’ayant pas d’ascendance camerounaise ? Si l’école, en tant qu’espace public, ne nous a pas transmis la connaissance de ce conflit, du moins aurais-je pensé que l’espace privé l’aurait fait. Or, tel n’a pas été le cas, notamment en ce qui concerne la troisième génération. Les témoins appartenant à la deuxième génération connaissent ainsi tous sans exception, au moins de manière superficielle, le conflit camerounais. Cette connaissance est plus variable pour les témoins de la troisième génération, certains n’ayant même jamais entendu parler des violences survenues au Cameroun avant la proposition d’entretien. Cette fracture entre deuxième et troisième générations met en exergue l’importance d’un contact humain direct dans la transmission de mémoires privées. Les personnes interrogées de la deuxième génération ont en effet grandi auprès de parents immigrés camerounais, ressortissants de la première génération et témoins des violences au Cameroun. Les travaux en sociologie, notamment ceux de Guila Fabbiano 11 et d’Abdelmalek Sayad 12, permettent de mieux comprendre ces mécanismes d’apprentissage de l’histoire familiale. Les ressortissants de la première génération, ayant vécu l’expérience difficile de l’exil, ne transmettent en effet généralement pas directement leur histoire à leur enfants. Cependant, cette transmission se produit de manière indirecte : par la langue, des gestes, des attitudes… La mémoire de la guerre camerounaise n’a pas fait exception à ce schéma de transmission. Ainsi, à la suite des entretiens réalisés avec les ressortissants de la deuxième génération puis-je mentionner que la guerre n’était pas directement évoquée au sein de l’espace familial. Le père conservait un silence, qui, s’il n’était pas d’honneur (en référence à la “conduite d’honneur 13” théorisée par Abdelmalek Sayad), était plus certainement traumatique. Un des fils interviewés précise qu’il a essayé, à plusieurs reprises, de questionner son père à propos du conflit camerounais. Cependant, dès que les violences étaient mentionnées, “il se fermait et devenait hermétique à toute question”. Une partie de la famille du père Camerounais, dont son propre père, avait en effet été tuée par des militaires français, et des personnes interviewées précisent qu’il n’était pas impossible qu’il ait personnellement assisté au massacre. La mère quant à elle évoquait le conflit de manière implicite, en comparant par exemple les leaders indépendantistes Ruben Um Nyobe et Patrice Lumumba. Cette transmission indirecte de la mémoire familiale, non sous la forme d’un récit se présentant comme tel mais bien plus grâce au contact direct avec des témoins de la guerre, n’est cependant plus effectuée entre les deuxième et troisième générations. Français n’ayant pas nécessairement d’intérêt spécifique pour le Cameroun, les témoins de la troisième génération n’ont pas fréquemment eu de contacts directs avec leurs grand-parents et de fait été sensibilisés à cette guerre. Leurs parents également, membres de la deuxième génération, ne mentionnaient pas ce conflit, évoquant pour principale raison le fait de ne pas connaître suffisamment ce pan de l’histoire. Il existerait ainsi bien, comme le mentionne Enzo Traverso, une “crise de la transmission 14”. Crise tout à la fois du côté de ceux qui racontent que de ceux qui reçoivent. Les témoins les plus jeunes évoquent par ailleurs leur éloignement vis-à-vis de l’histoire, cette dernière n’étant appréhendée que par le prisme scolaire. Dorénavant en poursuite ou fin d’études supérieures, l’histoire n’est ainsi plus une obligation et est pour ainsi dire déconsidérée, même dans un cadre privé.
Cependant, cette “crise” doit être nuancée, en témoigne ce travail de recherche conduit par une témoin et historienne de la troisième génération. Si je n’ai pas été particulièrement sensibilisée à la guerre camerounaise par ma famille jusqu’à il y a peu, mon intérêt pour ces questions a amené des membres de ma famille appartenant à la deuxième génération à évoquer plus amplement ces violences. J’ai donc assisté à une reprise de la transmission, cette dernière s’effectuant sous une forme beaucoup plus directe, comme par exemple des mises en récits. Finalement, c’est bien plus l’existence d’une transmission hétérogène au sein même d’une famille qui est mise en exergue, hétérogénéité soulignée par Giulia Fabbiano dans ses travaux 15.
Les témoins de la troisième génération, privés d’une transmission indirecte au contact de Camerounais immigrés, semblent plus éloignés du Cameroun que ceux de la deuxième génération : ils ne connaissent pas de langues vernaculaires, la plupart ne s’y sont jamais rendus, la culture camerounaise, notamment culinaire, est très peu présente dans l’espace familial… Un des témoins confie ainsi une absence d’intérêt pour le Cameroun, absence qui expliquerait selon lui sa méconnaissance du sujet. Cependant, je n’arrive pas à me satisfaire d’une telle justification. L’interviewé ne témoigne en effet pas d’un intérêt particulier pour l’histoire antique ou médiévale, et pourtant il connaît au moins de nom les batailles d’Alésia ou de Marignan. Sans intérêt spécifique pour l’Algérie ou l’Indochine, il connaît également les deux guerres d’indépendances, et peut les dater. Ces événements sont pour le témoin, étudiant en école de commerce, constitutifs d’une culture générale et doivent à ce titre être connus. Ils ont par ailleurs été appris à l’école, en cours d’histoire. Ainsi, un écueil apparaît : la guerre d’indépendance du Cameroun reste pensée par des Français ayant des racines camerounaises comme un événement censé intéresser uniquement des Camerounais ou membres de la diaspora, et non la population française dans son ensemble. Elle n’est pas assez signifiante ou constitutive d’une mémoire collective publique pour faire partie d’une “culture générale” qu’il conviendrait de posséder. Il émerge ainsi l’impossibilité de penser la mémorisation de cette guerre comme relevant d’un pays tout entier. Le fait que seule la diaspora camerounaise doive se sentir concernée esquisse une privatisation ou “communautarisation”, bien qu’involontaire, de la mémoire collective d’une guerre française. Un événement primordial pour comprendre l’histoire politique et géopolitique française est pensé comme étant du ressort uniquement d’une communauté spécifique. Il n’est pas “collectivisé”, inscrit dans un récit et une mémoire communs. Dès lors, il apparaît indispensable, pour une meilleure connaissance de la guerre d’indépendance camerounaise, que la mémoire de cette dernière se publicise, qu’elle sorte de la sphère privée pour la sphère publique afin de s’inscrire légitimement dans le récit national. L’institution scolaire peut à ce titre participer de cette publicisation des histoire et mémoire de l’événement, tout comme les médias. Je reviendrai sur ce dernier point dans la suite de mon article.
Par ailleurs, une lecture nécessairement plurielle du silence des ressortissants camerounais de la première génération s’impose. En plus des silences précédemment évoqués (ceux liés à une expérience traumatique ou à une expérience de déracinement et d’exil), la transmission mémorielle pourrait ne pas être réalisée en raison de la charge affective singulière qu’elle comporte. Charge affective au sens où par la transmission de cette mémoire, ce sont également des affects et sentiments que l’on risque de communiquer au désormais dépositaire de la mémoire. Plusieurs interviewés parlent en effet du risque pour les enfants de la deuxième génération “d’haïr la France” s’ils savaient l’entièreté du passé colonial de cette dernière. Le silence mémoriel doit ainsi être inscrit dans un parcours migratoire spécifique où l’intégration au sein de la société d’accueil est l’objectif premier. À partir de là, les immigrés de la première génération cherchent à éviter tout ce qui pourrait contrarier l’intégration de leurs enfants, comme le ressentiment vis-à-vis du pays d’accueil par exemple. Dans ce contexte l’oubli familial peut même être envisagé sous le prisme de l’omerta, bien que le caractère volontaire de cette dernière ne puisse expliquer l’entièreté du silence autour du conflit camerounais. De plus, les immigrés camerounais, occupant généralement une place précaire au sein de la société française, ne sont pas dans une position favorable pour effectuer des revendications mémorielles chargées politiquement. Pour étayer mes propos, je reprends à mon compte la métaphore d’Annette Wieviorka, cette dernière évoquant une “chaîne des générations 16, p. 134. ]” au sein de laquelle le témoignage circulerait. Cette chaîne, souligne l’historienne, peut être brisée. L’émigration, expérience de déracinement et de perte de repères, ou encore des traumatismes, peuvent conduire à stopper une transmission intergénérationnelle. Il semblerait qu’une telle brisure se soit produite pour les mémoires du conflit camerounais. Cependant, l’intégration au sein de la société française des deuxième et troisième générations a participé à la sécurisation de situations précaires et a pu constituer une sorte de baume, une réparation de cette chaîne brisée. Les descendants de cette première génération, de nationalité française pour la plupart, ont en effet des situations moins précaires, au minimum sur un plan légal. Certains d’entre eux souhaitent en apprendre davantage sur leur histoire familiale et nationale, et c’est par leurs demandes qu’ils reconstituent progressivement cette “chaîne des générations 17”.
Une entreprise mémorielle de “nationalisation” portée par les descendants d’immigrés camerounais ?
Les demandes des descendants d’immigrés camerounais restent cependant quelques fois sans réponse, les témoins de la première génération ne souhaitant parfois s’exprimer. Plus exactement, ils ne trouvent pas au sein de la société, ici française, le terrain propice à leur prise de parole. La société en effet ne souhaite les entendre. Je dresse dans ce paragraphe un parallèle entre les survivants du génocide juif et les témoins de la guerre camerounaise, bien que les ampleurs des deux violences soient dramatiquement différentes. Annette Wieviorka précise ainsi dans son ouvrage L’ère du témoin la nécessité, pour que “l’expression d’un souvenir […] pénètre le champ social 18” et dépasse le simple cadre familial clos, la nécessité d’un changement dans la configuration politique. Il faut que “le témoignage se charge d’un sens qui dépasse l’expérience individuelle, [que ce dernier] soit porté par des secteurs de la société 19”. En un sens, le témoignage doit être construit socialement : un témoignage n’en est qu’un que lorsque l’on estime que son contenu est digne d’intérêt et doit être conservé, transmis. Concernant la guerre d’indépendance camerounaise, besoin serait donc que des pans de la société française se saisisse des mémoires du conflit et les portent dans le champ social, sociétal. Nous aurions pu penser que des membres de la diaspora camerounaise installés en France se seraient saisis d’un tel rôle et se seraient constitués en “entrepreneurs de mémoire 20”. Il ressort en effet d’un entretien l’incompréhension d’un témoin :
“- Comment expliquez-vous ce relatif silence quant aux violences survenues au Cameroun ?
– En vérité c’est quelque chose que je ne m’explique pas. Je crois que la diaspora camerounaise en France est la plus importante d’Afrique subsaharienne. Oui, non, je ne comprends pas ce relatif silence.”
En raison du poids de la diaspora camerounaise en France, le silence relatif à ces événements est inexpliqué pour le témoin. Ce silence est certainement une conséquence de la “crise de la transmission 21 ” au sein des familles elles-mêmes, mais il révèle également une potentielle “crise de la réception”. Plus encore que des témoins et acteurs qui ne souhaiteraient évoquer cette guerre, c’est bien plus le contexte sociétal qui n’est favorable à une prise de parole remettant en cause le récit national. L’absence de cette guerre des programmes scolaires en est un exemple révélateur.
L’institution scolaire comme fabrique d’une (non) mémoire collective
Une guerre d’indépendance invisibilisée dans les programmes scolaires
À la différence de la guerre d’Algérie, la guerre du Cameroun n’est pas enseignée à l’école. Ainsi, aucun des témoins interviewés n’a mentionné avoir étudié cette dernière en classe, à la différence de la guerre d’Algérie. Le conflit algérien a été inscrit dans les programmes scolaires en 1983 et a donc de fait été étudiée par les témoins les plus jeunes. Lors des entretiens réalisés, nombreuses sont les références à ce conflit. Si certains évoquent le Front de Libération Nationale (FLN) ou l’Organisation Armée Secrète (OAS), c’est cependant bien plus la figure de Charles de Gaulle qui est mentionnée en tant qu’acteur central des décolonisations françaises. Un signe très certainement de la personnalisation de l’histoire autour de la figure de “grands hommes” (et plus rarement, de “grandes femmes”). Des confusions sont quelques fois mêmes réalisées entre les deux conflits. Un témoin répond par exemple que l’indépendance du Cameroun a eu lieu en 1962, mélangeant très probablement les indépendances du Cameroun et de l’Algérie. Je retrouve ici le constat effectué par Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire et Nicolas Bancel à l’issue de leur étude conduite à Toulouse en 2003 sur la mémoire coloniale : “la colonisation, quels que soient les angles sous lesquels on l’aborde, est identifiée d’abord et surtout par le prisme de l’Algérie (pays, guerre, population, histoire et, à un moindre niveau, religion) 22”. C’est dire que les mémoires du conflit sont présentes dans la sphère publique, et que les programmes scolaires abordent généralement le fait colonial sous l’angle d’une décolonisation violente, celle de l’Algérie. Laurence de Cock précise en effet l’importance de l’histoire scolaire dans son ouvrage Sur l’enseignement de l’histoire 23. Le programme scolaire constitue pour l’historienne tout à la fois un “outil pédagogique 24” et un “instrument de politiques publiques 25“. L’absence de références à la guerre du Cameroun dans les programmes scolaires est donc une sorte de “non-projet mémoriel”, elle ne semblerait pas relever pour l’institution scolaire (et ceux qui conçoivent ses programmes) de la mémoire collective française. À ce titre, elle ne nécessiterait pas d’être inscrite au récit national et d’être enseignée aux futurs citoyens,
Par ailleurs, les entretiens conduits rendent compte, outre la méconnaissance de la guerre camerounaise, que l’histoire coloniale française dans son ensemble est ignorée par la majeure partie des interviewés. Par exemple, les différents statuts des territoires anciennement colonisés ne sont pas connus : sont ainsi assimilés indifféremment à des colonies l’Algérie, le Maroc, le Cameroun, … alors que ces territoires étaient respectivement un département, un protectorat et un mandat français. Si les témoins précisent qu’ils ont étudié à l’école la guerre d’Algérie (notamment au lycée et en classe préparatoire le cas échéant. En terminale, le chapitre portait sur les mémoires du conflit.), la période coloniale à proprement parler ne semble que peu connue. Des confusions sont faites par les témoins entre les guerres d’Indochine et du Vietnam, et peu de personnalités liées aux décolonisations sont connues. Si Ferhat Abbas et Messali Hadj sont mentionnés par un témoin lors d’un entretien, jamais Ho Chi Minh n’est évoqué lors des interviews. Là encore se retrouve une conclusion de l’étude conduite à Toulouse précédemment évoquée, qui précise “la faible connaissance de l’histoire coloniale 26”. Cette faible connaissance, méconnaissance quelques fois même d’événements coloniaux, permet d’entrapercevoir l’importance de l’institution scolaire dans la construction et l’assimilation d’un récit national.
L’importance de l’école dans la fabrique d’une mémoire collective, d’un récit national
À travers la méconnaissance de la guerre du Cameroun, je décèle l’importance de l’institution scolaire dans l’apprentissage d’événements historiques : cette dernière participe à la construction d’un récit national et est le lieu de transmission d’une mémoire collective. Maurice Halbwachs, sociologue français, précise en effet que la mémoire collective est constituée “d’imagos” mobilisés par un groupe social (et non par l’individu lui-même). Le collectif permet ainsi de reconstruire des souvenirs, de constituer même une mémoire historique. Cette dernière est en effet composée, toujours selon Halbwachs, d’événements que l’individu n’a pas vécu lui-même mais qui lui sont transmis par un contexte social, comme la famille ou l’école par exemple. D’où l’existence d’un possible enjeu identitaire autour de la mémoire historique, qui influence l’identité actuelle du groupe. En ce qu’elle transmet un récit national, l’institution scolaire permet donc aux individus d’acquérir une mémoire collective et l’histoire (scolaire) ne doit pas être considérée comme cette “mémoire morte” selon Halbwachs, qui n’aurait plus d’influence sur le groupe. Au contraire, son potentiel conflictuel est important, en témoigne les polémiques relevées par Laurence de Cock dans son ouvrage sur l’enseignement de l’histoire 27. Les entretiens réalisés dans le cadre de mon projet de recherche en appelait à une mémoire individuelle mais indubitablement influencée par les cadres sociaux de la mémoire. Certainement que l’école constitue un tel cadre social de la mémoire, et le non-enseignement de la guerre du Cameroun conduit à ce que ces événements coloniaux ne soient pas inscrits dans la mémoire collective.
Lorsque la question est posée des moyens de lutter contre le silence collectif à propos des violences camerounaises, l’enseignement de cette guerre dans un cadre scolaire est invoqué par tous les témoins. L’institution scolaire est ainsi appréhendée comme un des lieux privilégiés de la construction d’une mémoire collective, la preuve en est par la négative. C’est en son sein notamment que s’inculque le récit national, que l’on se construit en tant que citoyen. C’est donc en son sein que la mémoire coloniale française doit être socialisée, débattue et partagée. Si je me réjouis des espoirs et attentes placés dans l’école, il faut cependant éviter de considérer cette dernière comme une panacée. Je reprends ici à mon compte l’avertissement formulé par Laurence de Cock : l’histoire en tant que discipline scolaire n’est pas et ne doit pas devenir cette une matière première dont le but initial serait de soigner les maux de la société. En en appelant à l’école, les personnes interrogées témoignent certainement de leur foi dans l’institution républicaine pour transmettre une mémoire collective douloureuse. Envisager cette transmission uniquement dans un cadre scolaire risque cependant de faire porter un fardeau trop lourd sur ceux qui font vivre au quotidien l’histoire scolaire, les professeurs. C’est en effet l’espace public dans son entièreté qui doit “nationaliser” cette mémoire, l’intégrer au récit collectif qu’un pays se donne à lui-même, et non seulement l’institution scolaire.
Un “passé qui ne passe pas” (Henry Rousso), la France en colonies
La guerre d’indépendance camerounaise, un “passé non encore arrivé”
Au sein de l’espace public cependant, la guerre d’indépendance camerounaise est tue, comme le symptôme d’un “passé non encore arrivé”. Alors qu’un “passé ne passant pas 28” aurait probablement pour caractéristique une hypermobilisation mémorielle et un “investissement considérable 29” d’acteurs divers, comme Henry Rousso et Eric Conan le décrivent dans Vichy, un passé qui ne passe pas, les témoins interviewés, pour tenter d’expliquer la méconnaissance des violences camerounaises dans la société française, parlent au contraire du faible nombre d’événements permettant de remobiliser les mémoires nationales et familiales. Il n’existe par exemple de commémorations officielles relatives à la guerre du Cameroun, alors que des journées nationales ont été instituées pour commémorer les violences survenues dans d’anciens protectorats et colonies. Le 19 mars est ainsi la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, le 8 juin la journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine, le 25 septembre la journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives tandis que le 5 décembre honore les morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. L’étonnement est permis quant aux journées des 19 mars et 5 décembre. En effet, il est raisonnable de penser que les “morts pour la France” sont compris dans les “victimes […] militaires” du conflit. Cette double commémoration nationale est certainement symptomatique de la “boulimie mémorielle 30” décrite et décriée par Pierre Nora, même s’il convient de nuancer mon propos. Ces hommages en effet ne sont que peu publicisés ou médiatisés. Ils ont cependant le mérite d’exister, et reconnaissent officiellement les combats s’étant déroulés au tournant de l’indépendance dans certains territoires de l’Empire français. Hommage est rendu également aux victimes civiles et militaires de ces conflits. Dès lors, comment comprendre que le Cameroun n’y figure pas ?
Cette absence est révélatrice de l’omerta officielle française autour de cette “guerre cachée aux origines de la Françafrique 31 ”. Ce silence étatique, encore en oeuvre plus d’un demi-siècle après les faits, pourrait s’expliquer par l’issue du conflit. Lors des entretiens en effet est mentionnée à plusieurs reprises l’indépendance factice du Cameroun obtenue en 1960, l’un des témoins précisant notamment que le président camerounais Ahmadou Ahidjo est un “pion” de la métropole. Nicolas Bancel préfère au terme de “pion” celui d’ “élites de compromis 32”. L’historien précise que la loi-cadre Defferre de 1956 initie des “États totalement ingérables sans l’aide métropolitaine 33“, créant de fait une relation de dépendance (et non d’indépendance), d’où selon lui “la poursuite sous d’autres formes du projet colonial 34”. Contrairement donc à l’Indochine devenue Cambodge, Vietnam et Laos, le Maroc, la Tunisie ou l’Algérie (bien que l’influence française reste prégnante dans les anciennes colonies, il ne s’agit pas ici de contester cette affirmation), le camp indépendantiste composé principalement de membres de l’UPC aurait “perdu” cette guerre d’indépendance. S’esquisserait donc un possible consensus naturel entre élites dirigeantes camerounaise et française post-indépendance afin de ne pas évoquer ces violences. Si la France évoquait ces dernières, cela aurait en effet remis en cause la légitimité des élites camerounaises au pouvoir, ces dernières étant redevables de l’aide de l’ancienne puissance coloniale face à des opposants politiques, dans les domaines militaire, économique, … La France perdrait potentiellement un important allié géopolitique régional et d’importants accords commerciaux et concessions économiques. Et l’État camerounais n’avait quant à lui intérêt à évoquer cette guerre, qui aurait mis en exergue la collaboration des élites gouvernementales avec la France contre les indépendantistes. De plus, comment justifier les relations cordiales entretenues avec l’ancienne métropole, sans demande aucune d’excuses ou de réparations symboliques ? Au Cameroun est ainsi mis en oeuvre un oubli volontariste jusque dans les années 1990 : interdiction est faite de mentionner les événements relatifs à l’indépendance, les leaders tels que Ruben Um Nyobe sont effacés de l’histoire officielle, les archives notamment militaires (bien que les auteurs de Kamerun ! rappellent l’importance des ordres non-écrits dans cette guerre) sont rendues inaccessibles. Dès lors, les témoins apparaissent comme les derniers relais d’une mémoire collective nationale que l’État tente délibérément de nier. Cependant, rappelle Benjamin Stora, “la prise de parole dépend de la capacité d’écoute 35”. Et la capacité d’écoute de la société française lorsqu’il est question de la guerre d’indépendance camerounaise est quasiment nulle. D’où le détournement de la formule d’Henry Rousso d’un “passé qui ne passe pas 36”. Tous débats et conflits mémoriels nécessitent en effet au préalable une publicisation et une médiatisation, au moins minimales, en quelque sorte cette “pénétration du champ social 37” par une question auparavant individuelle. En tant que “passé non encore arrivé”, la guerre du Cameroun n’a pas encore connu une publicisation suffisante à sa pénétration du champ social. Au sein du monde académique même, elle est relativement en retrait, peu évoquée. Elle reste uniquement un ressort de la sphère familiale, d’un cadre privé. C’est l’une des conclusions principales des entretiens réalisés dans le cadre de mon travail de recherche.
Poursuivant notre métaphore, je m’interroge cependant sur les raisons d’un tel “retard”. Serait-ce à cause d’un embouteillage involontaire ? L’hypermnésie mémorielle de la guerre d’Algérie aurait-elle ainsi empêché l’émergence d’autres mémoires coloniales collectives ? Je conviens à rappeler qu’il ne s’agit ici d’effectuer une pernicieuse concurrence mémorielle victimaire. J’ai rappelé précédemment mon vœu de ne voir aucune mémoire “communautarisée”, “privatisée” et mise en concurrence avec d’autres mémoires collectives. Au contraire, je souhaite plutôt comprendre les possibles conséquences de l’hypermnésie mémorielle du conflit algérien sur les autres mémoires.
La guerre d’Algérie a-t-elle monopolisé involontairement la mémoire collective ?
Tout d’abord, la guerre d’Algérie, si elle partage avec la guerre camerounaise la caractéristique de ne pas être nommée comme telle (Benjamin Stora parle de la “minimisation langagière d’une guerre 38”), mobilise plus intensément la métropole. Plus de deux millions d’appelés sont envoyés en Algérie, départements français, tandis que ce sont des militaires de métier qui luttent au Cameroun (ce furent également des Français militaires de métier qui combattirent en Indochine). Le père, le frère, le fils ou l’ami part ainsi en Algérie, sensibilisant de fait la population au conflit. La guerre d’Algérie fut également le théâtre, selon Benjamin Stora, d’une “double crise de la République et de la nation 39”, entraînant de fait un changement institutionnel et la création de la Vème République, de même que le retour au pouvoir du général de Gaulle, figure majeure de la Résistance contre l’Allemagne nazie. La guerre camerounaise est ainsi dès le départ, relativement à la guerre d’Algérie (les deux étant concomitantes), moins présente dans l’esprit français, dans les médias, les actualités.
Les mémoires à l’issue du conflit algérien (Benjamin Stora rappelle notamment que, contre l’idée d’un oubli ou d’une omerta, la mémoire est sans cesse réactivée. Entre les années soixante-dix et le début des années quatre-vingt par exemple, la mémoire se manifeste “massivement, à travers la production d’ouvrages 40”, principalement cependant d’un seul camp, français.) sont conflictuellement visibles sur le sol métropolitain, comme le prouve la chronologie réalisée par Benjamin Stora à l’issue de son livre et couvrant l’après-guerre de 1962 à 1990. Rien de tel pour les mémoires des violences camerounaises, cantonnées pour leur majorité à la sphère privée. Ces mémoire sans cesse réactivées participent probablement d’une meilleure connaissance de la guerre d’Algérie. La plasticité de la mémoire collective permet en effet de se remémorer plus aisément des événements historiques mieux exposés médiatiquement. D’autant plus que les mémoires douloureuses et non apaisées du conflit algérien sont désormais utilisées comme une clef de compréhension (à tort ou à raison) de la soi-disante “crise de l’intégration” des enfants et petit-enfants descendants d’immigrés algériens. Leur expression quelque fois violente serait la conséquence d’un refoulement mémoriel, et permettrait une “réactivation de la mémoire” à intervalles réguliers. Dans le champ académique même, la guerre d’Algérie est désormais “dominante dans l’historiographie coloniale 41” depuis la fin des années 1990.
Des entretiens émerge en effet la notion de “réactivation de la mémoire”. Ainsi, pour un témoin, les mémoires du conflit camerounais n’ont pas ou peu d’événements spontanés permettant de remobiliser les différents groupes. La mémoire, au contraire d’une matière inerte, doit s’envisager comme un élément malléable que le présent pourrait, si ce n’est modifier, du moins co-construire. Un interviewé cite à ce titre les mémoires de la guerre d’Algérie, ré-activées par des coups d’éclats médiatiques, quelques fois mêmes cathartiques. Il donne en exemple le match de football France-Algérie du 6 octobre 2001, au cours duquel la Marseillaise et des joueurs de l’équipe de France ont été sifflés. Le match fut en outre arrêté par l’arbitre à la 76e minute suite à l’irruption sur la pelouse de supporters de l’équipe algérienne. Ce match, “occasion de revisiter l’histoire des silences franco-algériens depuis l’indépendance ainsi que [mise] en exergue des mémoires tourmentées de la guerre d’Algérie 42” selon Yvan Gastaut, catalyse les problématiques liées à l’intégration des enfants de la deuxième génération d’immigrés algériens. Doté dès le départ d’une forte charge symbolique et mémorielle principalement par des acteurs politiques et médiatiques, ce “fiasco 43” réactive les mémoires non encore cicatrisées de la guerre d’Algérie. L’absence de tels événements médiatiques propres aux mémoires du conflit camerounais ne participe certainement pas à leur publicisation. Si la mémoire collective a été activée par le conflit lui- même, c’est dorénavant des incidents ponctuels qui sont les plus à même d’inscrire cette guerre au sein de l’espace public français. Annette Wieviorka par exemple, dans le cas de la mémoire de la Shoah, prend pour événement principal de réactivation de la mémoire le procès Eichmann à Jérusalem en 1961. Des événements, “électrochocs 44” pour Benjamin Stora, permettant, toujours selon l’historienne, l’avènement de “l’ère du témoin 45”.
Car, les témoins le précisent lors des entretiens, les non-références tout à la fois au sein des espaces privé que public participent de cette méconnaissance de la guerre d’indépendance camerounaise. Si personne n’évoque jamais cette dernière, comment imaginer l’importance des violences commises ? Au cours des entretiens émerge ainsi pour beaucoup de témoins la nécessité d’un déclic qui attiserait la curiosité et conduirait à mener de plus amples recherches sur le sujet. Ce “déclic” peut arriver à l’école, à la suite d’une actualité, grâce à une émission télévisée ou radiophonique, un film… À titre d’exemple, l’entretien réalisé constitua pour certains ce “déclic”, et sensibilisa ces derniers à la question de cette guerre. En somme, un décloisonnement, notamment médiatique, autour du conflit camerounais est nécessaire afin de multiplier les potentialités de survenues de ces déclics, parfois inconscients mais conduisant à une connaissance, même minimale, du sujet.
Le malaise français vis-à-vis du passé impérial
Nombreux sont par ailleurs les témoins à souligner une sorte de “malaise” français vis-à-vis du passé colonial, ce dernier étant pensé comme une simple périphérie de l’histoire nationale. Sandrine Lemaire souligne cette “césure nette entre histoire nationale et histoire coloniale 46”, ce schisme mémoriel entre colonial et national. Ainsi, “l’histoire de l’État- nation a-t-elle été séparée de celle de l’Empire 47”. Je retrouve ici la “communautarisation” des mémoires des violences camerounaises au contraire d’une “nationalisation”, ces dernières n’étant pensées comme étant significatives dans l’histoire nationale.
C’est dire que la France peut avoir “des difficultés avec l’écriture de son histoire 48”, comme le souligne Marc Ferro, étant donné que l’entreprise coloniale en elle-même était une trahison des valeurs de la République. L’historien a ainsi pu mentionner l’existence d’une “République parjure 49, p. 183. ]”. L’Empire français et les violences commises en son nom heurtent un récit national. Longtemps en effet, la colonisation fut cette “mission civilisatrice” : le pays des Lumières pensait qu’il devait éclairer des territoires considérés comme obscurs et arriérés, ces derniers ne pouvant que remercier la puissance coloniale qui venait les civiliser. Certainement que l’illusion d’une décolonisation pacifique au Cameroun participe de ce mythe d’une “mission civilisatrice”. Tout d’abord, il convient de rappeler que le mandat camerounais est intégré, par exemple dans les livres d’histoire scolaire, sans distinction aucune avec les autres colonies françaises d’Afrique subsaharienne, membres de l’Afrique équatoriale française (AEF) ou de l’Afrique orientale française (AOF). Cette confusion a pour conséquence qu’au cours des entretiens, aucun des témoins ne fait part du statut spécifique du Cameroun. Rappelons que la France, puissance coloniale, détenait son mandat de la Société des Nations (SDN) puis de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et qu’à ce titre, l’organisation internationale diligentait des missions d’observation sur le territoire mandaté. En évoquant une décolonisation pacifique, l’on renforce l’idée que les peuples dominés auraient consentis tacitement à la colonisation, omettant de fait les violences intrinsèques à l’ordre colonial lui-même et les nombreuses révoltes qui eurent lieu durant la domination française. Comme le précise un témoin, “c’est faux de dire que les peuples colonisés sont restés passifs”. Par ailleurs, la bonne entente apparente entre la France et ses anciennes colonies révèle les prémisses d’une Françafrique entre la métropole et les “élites de compromis 50” précédemment évoquées.
Finalement, comme nous confie Marc Ferro reprenant Fernand Braudel, découper “l’histoire en rondelles empêche de comprendre la colonisation dans sa totalité 51”. En pensant uniquement l’histoire coloniale selon les périodes “conquêtes et colonisations”, “décolonisations” et “post-indépendances”, l’on refuse de voir émerger des récurrences entre les trois périodes et de comprendre le colonialisme et l’impérialisme comme des phénomènes temporels s’inscrivant dans la durée. J’ai souhaité éviter le plus possible cette découpe réductrice, bien que ce travail ne fasse l’écueil d’une focalisation sur les épisodes traumatiques (les guerres de décolonisation principalement). Paraphrasant Marc Ferro, je pourrai également ajouter que découper une carte en rondelles empêche de comprendre la colonisation dans sa totalité. Lors des entretiens en effet, si des parallèles entre les guerres d’Algérie et du Cameroun sont effectués, celle d’Indochine n’est citée que très rarement. Plus généralement, lorsqu’il est demandé aux témoins de citer des colonies françaises, l’Indochine n’est jamais mentionnée, au contraire par exemple de la Nouvelle-Calédonie ou des Antilles françaises (que l’on aurait pu penser à tort comme moins “connues”). Il semblerait qu’existe ainsi une sorte de découpage entre les parties asiatique et africaine de l’Empire dans l’imaginaire français, en plus des possessions françaises en Océanie et dans les Antilles. Ce n’est pas que l’histoire mais aussi la géographie qui ont ainsi été “découpées en rondelles”. Comme la preuve d’une impossibilité de penser le colonialisme comme une idéologie et une manifestation s’inscrivant dans des espaces géographiques divers mais dont les schémas de domination présentent d’indéniables similitudes et familiarités.
Au sein du monde universitaire, des parallèles commencent cependant à être faits entre les (dé)colonisations algérienne et indochinoise. La revue Monde(s) consacre ainsi un numéro à des “comparaisons impériales 52” entre le Maghreb et l’Indochine aux XIXe et XXe siècles. Si je me réjouis de cette nouvelle lecture transcontinentale, l’exclusion du Cameroun de ces comparaisons et circulations résulte sans doute du silence et de la non-inscription dans la mémoire collective nationale de ces violences. La décolonisation camerounaise reste ainsi à part, comme un non-pensé de ces récurrences et similitudes. Pourtant, des militaires et officiers français ont oeuvré sur les trois terrains d’opérations, des “zones de pacification” ont été mises en place tant au Cameroun qu’en Algérie, la doctrine dite de la guerre révolutionnaire fut théorisée, perfectionnée et appliquée dans les trois conflits… Autant de faits qui devraient amener à une relecture et un renouveau de l’analyse des guerres de décolonisation françaises. En quelque sorte, ce travail de recherche illustre mon souhait d’inscrire cette guerre camerounaise dans la contemporanéité des autres guerres d’indépendance françaises. Car comme le souligne Tzvetan Todorov, “la représentation du passé est constitutive non seulement de l’identité individuelle […] mais aussi de l’identité collective 53”.
Épilogue
La (non) représentation de la guerre d’indépendance camerounaise dans les espaces public et privé m’implique personnellement. Elle nous implique également tous collectivement en tant que société, nous interroge sur nos oublis et focalisations mémoriels, sur ce qui constitue nos récit national et identités multiples. Au cours de la rédaction de cet article, j’ai utilisé à de nombreuses reprises les adjectifs qualificatifs “national” et “familial”. J’invite désormais le lecteur, s’il le souhaite, à interchanger les deux adjectifs. En effet, quel que soit l’adjectif utilisé, le sens de la phrase, quoique différent de par son échelle et ses différentes implications, demeure juste. Cette démarche réfléchie avait pour but principal de mettre en résonance et de souligner sémantiquement, non pas la similarité entre les deux termes mais leur résonance et écho l’un vis-à-vis de l’autre. Cet article témoigne en effet d’une expérience familiale s’entrechoquant avec un récit national, aussi ai-je voulu rapprocher les deux termes qualifiant chacun des histoires et mémoires collectives. L’interchangeabilité sémantique ne signifie cependant équivalence. Je n’ai en effet pas la prétention de considérer mon histoire familiale comme homologue ou assimilable à l’histoire nationale dans son ensemble. Il s’agit bien plutôt d’une analogie entre les deux histoires et mémoires. Les histoires et mémoires familiales sont en effet englobées dans les histoires et mémoires nationales, en sont des composantes légitimes et justifiées. Ce travail de recherche en histoire orale même, réalisé par une enfant de la ‘troisième génération d’immigré(s)”, appartient en quelque sorte à ces histoires et mémoires plurielles. Il révèle en quelque sorte une mise en abymes où le travail de l’historienne devient lui-même source pour l’historiographie contemporaine, d’où la réflexivité nécessaire évoquée dans le prologue de l’article. Par ailleurs, si cette partie est nommée “épilogue”, certainement que le terme est mal choisi. En effet, au contraire d’une conclusion qui clôturerait le débat ou les recherches, c’est bien plutôt une ouverture que je souhaite effectuer. En un sens, cet article tout entier peut être considéré comme le prologue de recherches futures sur la guerre d’indépendance camerounaise, sa mémorisation et ses transmissions familiale et nationale.
- Branche, Raphaëlle, Papa qu’as tu fait en Algérie. Enquête sur un silence familial. La Découverte, 2020. ↩
- Malagardis, opus cit. ↩
- Stora, Benjamin, La gangrène et l’oubli. La mémoire de la guerre d’Algérie. La Découverte, 1991, p. 38. ↩
- Stora, opus cit., p. 19. ↩
- Traverso, Enzo, Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique. La Fabrique éditions, 2005, p. 12. ↩
- Rousso, Henry, Conan, Eric, Vichy, un passé qui ne passe pas, Pluriel, 1994. ↩
- Jacob Tatsitsa, Manuel Domergue, Thomas Deltombe, Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique. 1948-1971. La Découverte, 2011. ↩
- Halbwachs, Maurice. La mémoire collective. Albin Michel, 1997 [initialement publié en 1950 ↩
- Nora, Pierre, “La mémoire collective”, in La nouvelle histoire sous la direction de Jacques Le Goff, Paris, 1978, p. 398. ↩
- Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Bulletin officiel spécial [en ligne ↩
- Fabbiano, Giulia. « Mémoires familiales en question », Revue Projet, vol. 311, no. 4, 2009. ↩
- Sayad, Abdelmalek. Histoire et recherche identitaire. Éditions Bouchène, 2002. ↩
- Sayad, Abdelmalek. « Entretien avec Hassan Arfaoui », Histoire et recherche identitaire. sous la direction de Sayad Abdelmalek. Éditions Bouchène, 2002, p. 44. ↩
- Traverso, opus cit. p. 12. ↩
- Fabbiano, opus cit., p. 56. ↩
- Annette Wieviorka, L’ère du témoin. Pluriel, 2013 [première parution en 1998 ↩
- Wieviorka, opus cit., p. 134. ↩
- Wieviorka, opus cit., p. 79. ↩
- Wieviorka, opus cit., p. 79. ↩
- Droit, Emmanuel, « Le goulag contre la Shoah. Mémoires officielles et cultures dans l’Europe élargie », Vingtième siècle, no 94, février 2007. ↩
- Traverso, opus cit., p.12. ↩
- Bancel, Nicolas, Pascal Blanchard, et Sandrine Lemaire. « 23. Les enseignements de l’étude conduite à Toulouse sur la mémoire coloniale », Nicolas Bancel éd., La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial. La Découverte, 2005, pp. 247-254. ↩
- De Cock, Laurence, Sur l’enseignement de l’histoire, Éditions Libertalia, 2018, 336p. ↩
- De Cock, Laurence. « Ce que les nouveaux programmes d’histoire en lycée(s) disent des réformes éducatives en cours », Raison présente, vol. 210, no. 2, 2019, p. 63. ↩
- De Cock, opus cit., p. 63. ↩
- Bancel, Nicolas, Pascal Blanchard, et Sandrine Lemaire. « 23. Les enseignements de l’étude conduite à Toulouse sur la mémoire coloniale », Nicolas Bancel éd., La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial. La Découverte, 2005, p. 248. ↩
- De Cock, opus cit. ↩
- Rousso, Conan, opus cit. ↩
- Rousso, Conan, opus cit. ↩
- Michel, Johann. « Qu’est-ce qu’une politique mémorielle ? », Gouverner les mémoires. Les politiques mémorielles en France, sous la direction de Michel Johann. Presses Universitaires de France, 2010, p. 1. ↩
- Jacob Tatsitsa, Manuel Domergue, Thomas Deltombe, Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique. 1948-1971. La Découverte, 2011. ↩
- Bancel, Nicolas. « La voie étroite : la sélection des dirigeants africains lors de la transition vers la décolonisation », Mouvements, vol. no 21-22, no. 3, 2002, p. 31. ↩
- Bancel, opus cit., p. 40. ↩
- Bancel, opus cit., p. 40. ↩
- Stora, opus cit., p. 266. ↩
- Rousso, opus cit. ↩
- Wieviorka, opus cit., p. 79. ↩
- Stora, opus cit., p. 38. ↩
- Stora, opus cit., p. 74. ↩
- Stora, opus cit., p. 238. ↩
- Lemaire, Sandrine. « 7. Colonisation et immigration : des « points aveugles » de l’histoire à l’école ? », Nicolas Bancel éd., La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial. La Découverte, 2005, p. 99. ↩
- Gastaut, Yvan. « 11. Préparatifs mouvementés pour le « match de la réconciliation » », Le métissage par le foot. L’intégration, mais jusqu’où, sous la direction de Gastaut Yvan. Autrement, 2008, p. 129. ↩
- Gastaut, Yvan. « 12. Stupeur et consternation : la faillite de l’intégration », Le métissage par le foot. L’intégration, mais jusqu’où, sous la direction de Gastaut Yvan. Autrement, 2008, p. 145. ↩
- Stora, opus cit., p. 290. ↩
- Wieviorka, opus cit. ↩
- Lemaire, opus cit., p. 96. ↩
- Lemaire, opus cit., p. 97. ↩
- « 11. La colonisation française : une histoire inaudible », Nicolas Bancel éd., La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial. La Découverte, 2005, p. 130. ↩
- Ferro, Marc, Le ressentiment dans l’histoire. Comprendre notre temps. Odile Jacob Poches, 2008 [2008 ↩
- Bancel, opus cit., p. 31. ↩
- « 11. La colonisation française : une histoire inaudible », Nicolas Bancel éd., La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial. La Découverte, 2005, p. 132. ↩
- Goscha, Christopher E, et Sylvie Thénault. « Maghreb-Indochine, xixe-xxe siècle. Comparaisons impériales », Monde(s), vol. 12, no. 2, 2017, pp. 9-20. ↩
- Tzvetan Todorov. Les abus de la mémoire. Arléa, 2015, p. 51. ↩

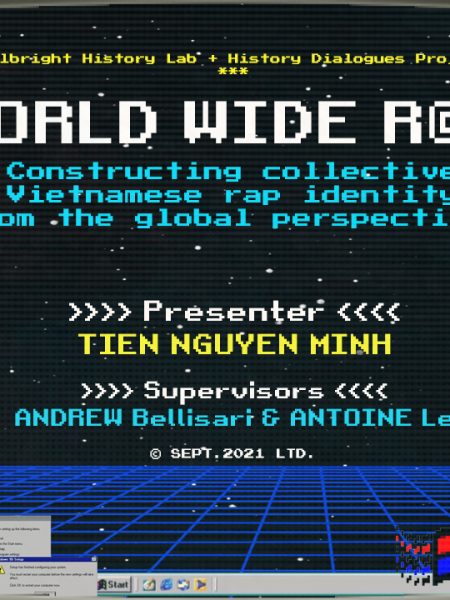











Great article.